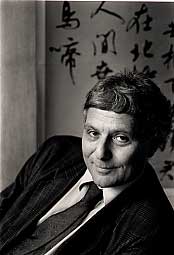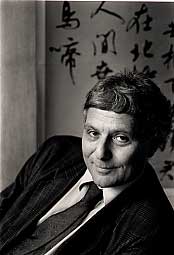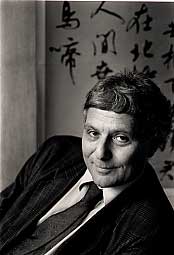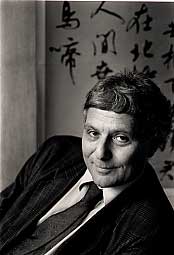|
|
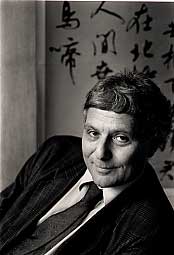

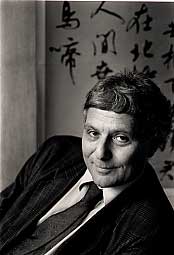
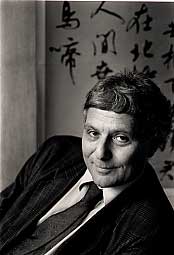
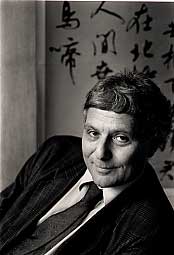
|
|
PHILIPPE
SOLLERS
L'Étoile
des amants, roman, Gallimard, 2002.
Le système
Sollers
Il
y a, paraît-il, un mystère Sollers : ses romans ne
s'embarrassent ni d'intrigues, ni de personnages, ni de cohérence
historique ; ses essais, allégés de toute note en
bas de page, n'ont rien d'universitaire ; ses biographies (Casanova,
Vivant Denon et dernièrement Mozart) sont avant tout des
livres de passion, et non de pure érudition. En un mot,
dans le paysage de la littérature française contemporaine,
Philippe Sollers demeure une exception.
Son dernier livre,
L'Etoile des amants, fait hurler le Landerneau parisien.
Est-ce bien un roman (comme son sous-titre devrait l'attester)
? Un récit ? Un simple (mais très subtil) collage
de citations ? La plupart des critiques français y perdent
leur latin, ceux-là même qui, chaque année
à pareille époque, lancent la " course au Goncourt
". Décidément, Sollers est inclassable…
Disons-le tout de
suite : L'Etoile des amants vaut mille fois mieux que toutes
les polémiques que le livre a suscitées. C'est un
texte d'une rare intelligence (ce qui ne surprendra personne)
qui mêle à la manière des promenades philosophiques
du XVIIIe satire sociale et poésie, art du détachement,
réflexions sur l'époque et invention d'un nouveau
langage amoureux. Et c'est encore un texte d'une profonde beauté
qui fait sonner la langue française comme une musique secrète.
De quoi s'agit-il
? D'une escapade amoureuse, bien sûr, comme presque tous
les romans de Sollers. L'heureuse élue s'appelle ici Maud
(on n'en saura pas beaucoup plus que ce mot : Maud). Avec elle
le narrateur, une fois de plus, coupe les ponts. " Un
caprice, une fantaisie, rien à perdre. Tentons le Temps.
Qu'il se montre enfin, fleur ou tête de mort. Ou les deux.
" Allégés, enfin, des contraintes sociales
et familiales, les amants mettent le cap sur une île qui
pourrait être celle de Cythère, chère à
Watteau. C'est là qu'un nouvel art de vivre va peu à
peu s'inventer : sommeil, musique, saoulerie de couleurs et de
parfums perdus, escapades nocturnes, lectures, jouissance de l'instant
: " le temps est une poudre dégagée pour
nous, brûlant tout (vives protestations dans la salle).
Feu du temps, montée en cadence. Reviens, dormons encore
un peu. Taisons-nous. "
Il y a dans ce retour
à la solitude amoureuse à la fois une fuite (comment
échapper à la doxa sociale, au " spasme
désespéré devenu système "
?) et, bien sûr, une extraordinaire libération (éloge
appuyé des libertaires, des réfractaires, des révoltés
– en un mots des artistes). Une affirmation de la pure jouissance
d'exister. C'est là que Sollers excelle : dans ces
collages de citations (parfaitement anonymes), d'instants volés,
de minutes heureuses, d'énumérations jouissives,
de dialogues abrupts, de sensations elliptiques. " C'est
cela même le propre du poète : celui dont les paroles
vont dans toutes les directions. "
N'en déplaisent
aux puristes, Sollers aligne les fragments comme on tissait les
anciennes rhapsodies. Il ne faut donc pas s'étonner qu'on
passe ici d'un narrateur omniprésent (mais sans visage)
à Nicolas Flamel, puis d'une poissonnière appétissante
à Cléopâtre, puis à l'éloge
des violettes, puis encore au célèbre sonnet des
Voyelles de Rimbaud. De l'un à l'autre, on l'aura compris,
un même phénomène d'alchimie des mots et des
sens. L'écrivain est le seul capable de transmuer l'expérience
corporelle en poésie – c'est-à-dire en or véritable.
Chaque nuit elle
est là, fidèle et éblouissante, cette étoile
qui guide les amants. C'est tantôt une étoile, d'ailleurs,
et tantôt un bateau qui vient chercher les amoureux sur
le départ. On lève les yeux, elle est là
; on ferme les yeux, elle est toujours là. Nouveau voyage
et nouvelle vie. Mais qu'emporter avec soi ? " Quelques
poèmes, pas n'importe lesquels. Avant tout la respiration,
le ciel, les couleurs. Vous lisez le monde en vous-même
? Oui, et réciproquement. Sans fin ? Sans fin. "
RETOUR
HAUT DE PAGE
|
PHILIPPE
SOLLERS
Casanova l'admirable, Plon, 1998.
Giacomo Casanova, Histoire de ma vie (trois volumes), collection
Bouquins, Laffont, 1993.
Casanova
l'Européen
Parce
qu'il est devenu un nom commun (on parle d'un casanova
comme d'un don juan), on croit connaître Giacomo
Casanova, né à Venise en 1725 et mort à Dux,
en Bohême, il y a exactement 200 ans. Pourtant rien n'est
moins sûr. Car Casanova, autant qu'un séducteur épris
de liberté et de plaisirs, fut d'abord écrivain,
et aussi philosophe en action. Philippe Sollers, qui partage
tant de traits avec le Vénitien, et depuis si longtemps,
nous le rappelle aujourd'hui dans un livre magnifique intitulé
Casanova l'admirable.
–
Voltaire, Sade, Vivant Denon et maintenant Casanova. Il semble
que le XVIIIème soit un peu votre siècle. Pourquoi
?
Philippe
Sollers : C'est peut-être une question physique. Après
tout, on passe sa vie à rejoindre son corps. Les premiers
éblouissements que j'ai eus ont passé par la peinture
et la musique. Sur les murs de ma chambre d'enfant, à Bordeaux,
mes parents avaient imaginé placer des reproductions de
tableaux de Watteau, Fragonard. Pour la musique, c'était
Mozart et Don Giovanni, bien sûr. C'est-à-dire
déjà Casanova. Voilà pourquoi, peut-être,
il faut que j'y retourne sans cesse.
–
En lisant votre livre, on a l'impression que Casanova a été
l'objet d'un immense refoulement. Pourquoi ?
–
C'est d'abord une question politico-historique. Le XVIIIème
est le siècle des Lumières et d'une liberté
encore jamais connue auparavant. C'est plus tard, dans le courant
du XIXème, que tout va s'étrangler, se limiter,
se censurer. Quant au XXème, il n'a pas que poursuivre,
à sa manière, et achever le grand refoulement du
XIXème. J'ai l'impression que ces deux siècles demanderaient
à être enjambés. Et l'enjambeur idéal,
c'est Casanova.
–
Destin extraordinaire que celui de L'Histoire de ma vie**
de Casanova : écrite en français, traduite en allemand,
retraduite en français selon la traduction allemande, passée
pour perdue, et qui survit aux grands massacres de ce siècles
pour ressurgir en 1960…
–
C'est assez ahurissant, en effet. Car la première version
française, parue au XIXème siècle, est due
aux soins de Jean Laforgue, professeur de français et censeur
scrupuleux. (Exemple du travail de Laforgue : là ou Casanova
écrit : " J'ai toujours trouvé que celle
que j'aimais sentait bon, et plus sa transpiration était
forte, plus elle me semblait suave. ", le digne professeur
traduit : " Quant aux femmes, j'ai toujours trouvé
suave l'odeur de celles que j'ai aimées. ") Le
plus grave, c'est que cette version a influencé beaucoup
de monde (Stendhal, en particulier), puisque c'était la
seule qu'on connaissait. Or il faut lire Casanova dans le texte,
c'est l'un des plus grands écrivains du XVIIIème,
au même titre que Voltaire, Rousseau ou Diderot.
–
En quoi Casanova fait-il scandale aujourd'hui ?
–
D'abord il fait scandale dans la mesure où il est rigoureusement
incompatible avec l'idée qu'on se fait de lui. Le scandale,
c'est d'être aussi différent de la propagande qui
a été organisée à travers le cinéma
(regardez ce pauvre Casanova de Fellini, réduit
à une sorte d'automate sexuel) ou la légende (il
est devenu un mythe publicitaire). Ensuite, il fait scandale par
sa profondeur. On l'aimerait diffus, léger, superficiel,
alors qu'il est tout le contraire : simple, direct, courageux,
cultivé, drôle. Un philosophe en action.
–
Quel rôle tient la femme dans ce scandale ?
–
Par définiion, c'est toujours par là que le scandale
éclate. Regardez les photos saisissantes de Monica Lewinsky
passant, du mois de février au mois d'octobre, d'une apparence
certes un petit peu grasse à une ogresse de 90 kilos. Les
clergés changent (au XIXème, c'était la censure
professorale ; aujourd'hui, c'est la justice du procureur Starr),
mais le scandale est toujours le même. La seule chose qui
change vraiment, c'est la mise en scène du scandale.
–
On retrouve dans ce livre tous les thèmes qui vous sont
chers : la fête, Venise, l'amour comme jeu. On est
loin de la chair triste du XIXème ou du XXème
(Houellebecq)…
–
Je pense que les écrivains disent toujours la vérité
de leur époque, que ce soit Mallarmé, Houellebecq
ou Casanova : ils dressent un constat rigoureux sur l'état
du désirde leur temps, et ce constat fait scandale.
Parce que la société de spectacle, celle qui nous
domine aujourd'hui, tend à évacuer ce constat, comme
elle cherche à évacuer sa propre Histoire.
–
" Casanova, homme d'avenir ", écrivez-vous…
–
Oui, pour des raisons très faciles à comprendre,
l'Europe sera des Lumières ou ne sera pas. Pour cela, je
suis plutôt optimiste, contrairement à la vague dépressive
qui nous submerge. Ce n'est pas par hasard, à mon sens,
si les textes de Casanova nous reviennent au moment même
où nous sautons dans une autre dimension politique de l'Europe.
Probablement que ce pauvre Casanova, né à Venise
en 1725, écrivant en français son Histoire de
ma vie, puis enterré en allemand dans le nord de la
Tchécoslovaquie, est un exemple (ou un modèle) pour
l'homme européen à venir.
–
Venise, Vienne, Prague : c'est aussi le triangle magique Mozart-Da
Ponte-Casanova. Se sont-ils rencontrés ?
–
En septembre 1787, Mozart est à Prague, Aux Trois Lions.
Da Ponte à l'hôtel Plattensee. Les deux hôtels
sont si proches que le musicien et son librettiste peuvent se
parler par les fenêtres. Casanova arrive. Il veut faire
éditer un gros roman de science-fiction. Casa connaît
da Ponte, qui le présente à Mozart. C'est l'époque
de Don Giovanni. Tout s'éclaire alors. Impossible
de ne pas voir Casa derrière ou sous le masque de Dom Juan
– et tout l'opéra de Mozart fasciné par ce
grand séducteur-philosophe.
RETOUR
HAUT DE PAGE
|
PHILIPPE
SOLLERS
Studio,
Paris, Gallimard, 1997.
Studio
De
Philippe Sollers, on a tout dit, tout et le contraire de tout,
de sorte que sa figure, aujourd'hui, est plus brouillée
que jamais. Pourtant, il y a ses livres – sorte d'OVNI dans
le paysage littéraire français – qu'on se garde
bien de lire, des fois que…
Avec
Studio, Sollers prend une fois encore le contre-pied de
ce qui se pense aujourd'hui. Alors que tout le monde prêche
pour l'intégration au sein du grand village global,
le politiquement correct et la pensée unique, il fait résolument
bande à part, fuit les grands rassemblements populaires,
s'enferme dans son studio. Non tant pour s'isoler du monde que
pour mieux l'étudier (dans studio il y a étude),
lui opposer une farouche résistance. " Tous ces
squelettes virtuels, là, et le mien parmi eux, appartements,
autobus, métros, avions, trains, voitures, trottoirs :
quelle montagne. Mais on a beau leur montrer des charniers, rien
n'y fait, ils font chaque fois comme si rien ne s'était
passé. L'hypothèse est donc très sérieuse
: ils vivent sous hypnose. Et toi, tu es réveillé
? "
Roman
de la veille et de l'éveil (comme Finnegan's wake),
Studio désigne un lieu au cœur du monde, mais
comme exclu de lui, une tour de guet ou un observatoire qui permettrait
d'étudier l'envers du décor. La comédie sociale
d'un côté, avec ses pitres et ses mages (terrible
portrait de Mitterrand comme momie), et la littérature
de l'autre, Hölderlin et Rimbaud, phares balayant leur siècle
d'une lumière si vive qu'elle nous aveugle encore aujourd'hui.
Éloge
de la solitude, enfin, alors que le monde prêche la grégarité,
mais une solitude qui serait une écoute de l'enfance :
" Ce corps d'enfance à sauver, à laisser
monter, se définit surtout par la distraction. C'est en
étant distrait, le plus distrait possible, que j'ai observé
et classé le monde où j'étais jeté.
Comme tout passe d'abord par le son, la fièvre monte, les
tympans battent, j'ai l'impression d'avoir été sourdement
désigné pour les écouter. "
RETOUR
HAUT DE PAGE
|
PHILIPPE
SOLLERS
La
Guerre du goût, Paris, Gallimard, 1994.
L'archipel
du langage
–
Votre livre s'ouvre sur une image forte : la chute du Mur de Berlin.
En quoi cette événement vous paraît-il révélateur
ou fondateur ?
–
Pour moi, c'est l'acte de décès, au choix, du XIXème
siècle ou du XXème.On l'a dit, maintes fois, mais
on ne le répétera jamais assez : dans les paysage
littéraire contemporain, Philippe Sollers fait tache. Auteur
précoce (" parrainé " par Aragon et Mauriac),
tour à tour classique, moderniste, maoïste, farceur,
imposteur, papiste, voltairien, il a plus d'une corde à
son arc, comme tous les Sagittaires. Et surtout (ce qu'on ne lui
pardonne pas) il montre le même talent dans tout ce qu'il
écrit : romans, essais, entretiens, interventions diverses.
L'archipel
Sollers
Son
dernier livre, La guerre du goût, énervera
plus d'un lecteur, comme ses ouvrages précédents.
Trop de verve, trop d'intelligence, trop d'esprit. Comment
peut-on écrire, c'est-à-dire penser, à cette
vitesse ? Comment peut-on toucher autant de domaines de l'activité
artistique, autant d'époques, autant de genres, avec cette
sorte de détachement, un peu hautain, mêlé
de connaissance et de complicité ? Bref : comment ose-t-on
passer ainsi de Proust à Rimbaud, en passant par Bossuet,
Mozart, Miles Davis et La Fontaine, mais encore Kafka, Dante,
Rodin, Marivaux, sans oublier Joyce, Sainte-Beuve et Guy Debord,
De Kooning, Sade et Fragonard ?
Il
y aura toujours un malentendu à propos de Sollers : quand
on s'attend à lire un livre (on nous a bien appris
à faire une chose à la fois), Sollers nous en balance
dix, ou vingt d'un coup. Ici, il poursuit son exploration
transversale (c'est-à-dire diachronique) de l'art et de
la littérature, mélangeant les époques et
les genres, comparant parfois l'incomparable, ou méditant
sur certains événements récents (comme la
grève des infirmières). A chaque fois, Sollers apporte
un éclairage essentiel à l'objet qu'il examine.
Genet, grâce à lui, retrouve la place qu'il n'aurait
jamais dû quitter dans la littérature de l'après-guerre
: centrale. Fragonard quitte les salons mondains pour recevoir
une lumière âpre et dérangeante. Rodin se
voit ausculté magistralement, corps et âme, lui qu'on
a toujours cherché à occulter. Céline se
voit poussé dans ses derniers retranchements, à
la fois admirables (son combat amoureux contre la langue française)
et détestables (ses prises de positions racistes).
Le
livre de Sollers, son titre l'indique assez, se présente
comme une machine de guerre. Citant Debord et Clausewitz, Sollers
élabore une stratégie de défense guerrière
" où la victoire n'est pas seulement plus probable,
mais où elle doit atteindre la même ampleur et la
même efficacité que dans l'attaque ". Dans
cette optique, on voit que chaque objet particulier (il y en a
une cinquantaine dans le livre) est le lieu et l'enjeu d'une bataille
que Philippe Sollers, en habile tacticien, remporte le plus souvent
avec brio.
En
résumé, un livre magnifique, mené au pas
de charge, et qui aura marqué l'année 94 par son
intelligence, sa force et ses prémonitions.
RETOUR
HAUT DE PAGE
|
PHILIPPE
SOLLERS
Les Folies Françaises,
Paris, Gallimard, 1994.
Dans
Les Folies Françaises, Sollers s'en prend aux filles,
– non plus aux femmes, encore moins aux mères. C'est
avec une discrétion inattendue qu'il décline, sur
tous tons et tous les modes de la langue française, l'amour
d'un père pour la fille qu'il vient de retrouver. Il ne
l'a pas connue. Elle a vécu loin de lui. Elle réapparaît
soudain à l'âge de dix-huit ans. Le récit
décrit leurs pérégrinations durant ces trois
années de vie commune.
–
En quoi vos Folies Françaises s'inscrivent-elles
dans la suite de vos autres romans ?
–
Quoiqu'on en pense, ce livre n'est pas un catalogue plus ou moins
méticuleux des différentes positions d'un romancier
aventureux par rapport à des femmes. C'est au contraire
un livre extrêmement réservé. En quelque sorte
la clé des livres précédents...
Votre
Portrait d'un Joueur était un lent retour vers la
terre de vos origines, le bordelais. Est-ce que Les Folies
Françaises forment, elles aussi, un retour aux sources
?
–
Dans Le Portrait, le narrateur faisait retour vers ce qui
l'a nourri – ses racines, Si vous voulez. Ici, au contraire,
il est chargé de transmettre son savoir. Tout le livre
se déroule à Paris. Le narrateur et sa fille se
promènent, ils conversent beaucoup, ils passent leur temps
en entretiens particuliers. Il s'agit d'une initiation...
…sexuelle...
?
–
Au contraire de Femmes, par exemple, ou encore du Cœur
absolu, dont c'était le sujet plus ou moins caché,
la trame sexuelle est ici presque absente. Rien n'est directement
dit. La présence sexuelle est diffuse. Le livre entier
baigne dans un climat de sensualité.
Vous
reprenez le même fil, mais à l'envers...
Oui.
Pour que la peinture que je cherche à donner soit complète,
il faut procéder à l'apparemment contraire!
Tout
le livre tourne autour d'un rapport incestueux. Et pourtant, le
mot d'inceste apparaît rarement. L'inceste vous fait-il
peur ?
–
Dès qu'on dit ce mot, on ferme tout! Ce mot est tabou.
Il est montré toujours comme quelque chose de violent,
soumis à une punition fatale. Un châtiment tragique.
Or, dans mon livre, rien ne se passe de tragique, de punissable,
de répréhensible. La " consommation de l'inceste
se fait dans une dimension extrêmement particulière
– euphorique, Si j'ose dire...
À
un moment donné, le narrateur dit qu'entre France (sa fille)
et lui, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé...
–
Oui, exactement. Cela suppose que ce qui se passe vraiment doit
se passer comme s'il ne se passait rien ! Si l'on manque
cette dimension symbolique, tout tourne immédiatement à
la caricature. Et, une fois de plus, on manque tout. En particulier,
ce côté hors du monde, hors du temps ou de l'histoire.
Je cherche toujours ce point différé hors du temps,
hors de l'histoire.
Vous
rejoignez Pierre Legendre qui, dans son dernier livre, insiste
précisément sur l'aspect purement symbolique de
l'inceste dans la plupart des civilisations...
–
C'est tout à fait exact. Il faudrait arriver à ce
point, certainement miraculeux, où le passage à
l'acte s'inscrirait dans la structure reconnue comme telle. Est-ce
que c'est possible ? Est-ce que le passage à l'acte implique
l'aveuglement face à la structure ? Ou est-ce que la reconnaissance
de la structure interdit le passage à l'acte ?
Est-ce
que les deux peuvent coïncider ?
–
Je crois que oui : dans l'art.
Vous
poursuivez deux pistes parallèles : l'une romanesque et,
disons-le, assez traditionnelle, et l'autre plus risquée,
qui s'appelle Paradis, ce long poème au rythme haletant,
dont deux volumes jusqu'ici ont paru. Est-ce que ces pistes se
rejoignent ?
–
Elles ne forment qu'une seule piste – bifide. Sans doute
doivent-elles converger quelque part, à l'infini peut-être.
Le mot de paradis indique bien cette convergence. Il y
a un versant figuratif et un versant non-figuratif, auditif, d'un
même phénomène.
Vous
travaillez sans cesse entre l'œil et l'oreille...
–
J'essaie de faire passer l'écriture entre ces deux marges-là,
sans qu'il y ait d'antinomie.
Chacun
de vos livres fait scandale, comme si, chaque fois, vous mettiez
le doigt sur une cicatrice irritante. Que va-t-on reprocher cette
fois à vos Folies Françaises ?
–
Le scandale va venir, j'en suis sûr, mais d'ailleurs. On
va dire : " Comme c'est bâclé ! Comme c'est
vite fait Trop facile ! Etc. " La censure, aujourd'hui, s'exerce
de cette façon-là. Elle a appris, la censure, comme
un beau virus qu'elle est, à se dissimuler derrière
des attitudes plus sournoises, moins violentes, mais sans doute
tout aussi efficaces...
RETOUR
HAUT DE PAGE
|
|
|
|

![]()